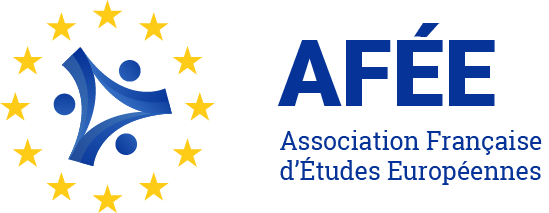Ludovic Benezech
Maître de conférences
Université Clermont Auvergne
Dans une décision du 9 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État français en raison d’une violation du droit à un procès équitable. Cette affaire est une belle l’occasion de revenir sur la théorie du « formalisme excessif » dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre du droit d’accès à un tribunal.
En l’espèce, le requérant exerçait une activité de promotion immobilière à travers un groupe de sociétés et eut recours à une procédure d’arbitrage afin de résoudre un différend financier l’opposant à la société Édifice de France. Par une sentence en date du 15 novembre 2013, l’arbitre a condamné le requérant à verser près de 2 000 0000 d’euros à ladite société. Le requérant forma ainsi un recours en annulation sur papier à l’encontre de cette sentence arbitrale auprès de la Cour d’appel de Douai. La recevabilité de ce recours fut contestée par ses contradicteurs au motif que l’acte aurait dû être déposé par voie dématérialisée. Par deux arrêts du 7 mars 2016 et du 18 janvier 2018, la Cour d’appel de Douai a, dans un premier temps admis la recevabilité du recours en annulation par voie papier et dans un second temps, annulé la sentence arbitrale. Saisie d’un pourvoi dirigé contre ces deux arrêts, la Cour de cassation a prononcé le 26 septembre 2019 la cassation de ces deux décisions.
En effet, la Cour de cassation a estimé conformément aux dispositions 930-1 du Code de procédure civile que « la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique ». C’est ainsi que le 17 mars 2020 le requérant déposa une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme invoquant une violation de l’article 6 et de son droit d’accès à un tribunal. En substance, la Cour européenne fera largement droit à ces prétentions en estimant que les circonstances particulières de l’espèce imposent parfois de déroger à l’obligation (jugée en principe légitime) de déposer un recours par voie électronique.
Cette affaire est particulièrement intéressante en ce qu’elle s’inscrit dans un contexte normatif et jurisprudentiel nourri renvoyant à la question fondamentale de l’accès au droit et au juge dans le cadre d’une société démocratique de plus en plus numérisée. En effet, il n’est pas anodin de rappeler que le Conseil d’État a rendu le 3 juin 2022 un avis et une décision au sujet de la généralisation de la procédure dématérialisée des demandes de titres de séjours. Dans une approche à la fois pragmatique et soucieuse de la garantie effective des droits des usagers, le juge administratif impose au gouvernement d’assurer des solutions de substitution afin de ne pas priver de facto les étrangers défavorisés et sans accès réel ou satisfaisant à l’internet, du droit de pouvoir déposer une demande de titre de séjour (CE, Section, 3 juin 2022, n°452798). Si cette décision ne figure pas à l’évidence au sein de l’arrêt commenté, il n’en demeure pas moins que le raisonnement juridique adopté n’est pas étranger, du moins sur certains aspects, à celui retenu par la Cour européenne. En effet, dans la droite ligne de sa traditionnelle jurisprudence visant à garantir des droits « non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (CEDH, 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73, § 24), la Cour européenne fait preuve, à la différence de la Cour de cassation, d’un sain pragmatisme (I) et d’une finesse (II) jurisprudentielle au service de l’effectivité du droit fondamental d’accès à un juge.
I. Le pragmatisme de la Cour européenne
Ce n’est pas la première fois que la Cour européenne est invitée à se pencher sur la notion de formalisme excessif. Dans cette affaire, cette notion jouit d’une place significative tant au niveau de l’examen de la recevabilité (A) que du bien-fondé de la requête (B).
A. L’appréciation souple de l’épuisement des voies de recours
Le gouvernement estimait que la requête était irrecevable faute d’épuisement des voies de recours internes. L’argument était sérieux, car le requérant n’avait pas explicitement « formulé le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 dans son mémoire en défense devant la Cour de cassation » (§ 34). De l’aveu même de la Cour, aucune des parties au litige n’avait soulevé la violation de l’article 6 devant la Cour de cassation qui était pourtant saisie d’un litige portant sur la question du droit au recours. Toutefois, au-delà du mot (l’article 6), la Cour européenne retient la chose (le procès équitable). En effet, elle estime que la discussion entre les parties renvoyait aux difficultés de saisir en ligne la Cour d’appel de Douai et que par conséquent, « le droit d’accès à un tribunal était en cause de façon sous-jacente dans l’argumentaire présenté par le requérant devant le juge de cassation » (§ 38). La juridiction strasbourgeoise en conclut ainsi que le grief tiré de la violation de l’article 6 a été invoqué en substance devant les juridictions internes permettant ainsi d’épuiser les voies de recours internes disponibles.
Ce faisant, la Cour fait résonner concrètement sa jurisprudence constante depuis près d’un demi-siècle selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours doit être appliquée « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » (§ 36). Conformément au paradidme des juges de la CEDH, l’approche n’est pas seulement formelle, mais bien matérielle : peu importe que l’article 6 n’ait pas été explicitement invoqué à partir du moment où le débat contradictoire a porté sur des thématiques relevant, de facto, du champ d’application du droit à un procès équitable. Cette appréciation généreuse des conditions de recevabilité de la requête permet à la Cour de ne pas déclarer irrecevable une requête qu’elle estime bien fondée. En s’appuyant sur l’argumentaire implicite du requérant – la Cour estimant que l’article 6 était bien en cause de « façon sous-jacente » – les juges européens refusent de se laisser enfermer dans une appréciation rigide des conditions d’épuisement des voies de recours. L’hypothèse de ne pas déclarer une requête irrecevable au motif que le grief a bien été soulevé devant le juge interne, non pas explicitement, mais implicitement, avait déjà été évoquée par la Cour dans une précédente décision. En effet, dans l’affaire Association les Témoins de Jéhovah, (CEDH, Irrecevabilité, 21 septembre 2010, Association les Témoins de Jéhovah c/ France, n° 8916/05) la Cour relève que le grief tiré de la violation des articles 14 et 9 a bien « été soulevé devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, mais qu’il n’a pas été invoqué devant la Cour de cassation, y compris de manière sous-jacente ». Une telle précision signifiait, selon toute vraisemblance, qu’un grief tiré de la violation de la Convention présent de manière sous-jacente dans les écritures était susceptible de remplir l’exigence d’épuisement des voies de recours.
L’arrêt Xavier Lucas confirme pleinement cette hypothèse et poursuit la politique jurisprudentielle d’assouplissement des conditions de recevabilité. Il était bien établi que le grief pouvait être soulevé « en substance » (CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c/ Italie, n° 7367/76, § 71) ou « au moins en substance » (CEDH, 25 août 1987, Englert c/ Allemagne, n° 10282/83, § 31), il peut même l’être désormais « de manière sous-jacente ». Ce dynamisme interprétatif n’est guère surprenant, car comme le rappelle à juste titre l’arrêt CGAS du 15 mars 2022, la Cour interprète « de manière réaliste » l’article 35-1 de la Convention (CEDH, 15 mars 2022, Communauté Genevoise d’action Syndicale (CGAS) c/ Suisse, n° 21881/20, § 53). La clémence jurisprudentielle est ici entièrement animée par la logique d’effectivité : la Cour n’envisage pas de paralyser l’exercice du droit de recours individuel, figurant parmi « les clefs de voûte de sauvegarde des droits », sur l’autel de la rigidité normative (CEDH, (GC), 4 février 2005, Mamatkoulov c/Turquie, n° 46827/99, § 122).
B. Le rejet d’un « formalisme excessif » dans l’appréciation du bien-fondé de la requête
« La jurisprudence de la Cour désapprouve l’excès de formalisme », comme le résument parfaitement les juges Popovic, Yudkivska et De Gaetano dans leur opinion commune dissidente sous l’affaire Vuckovic (CEDH, (GC), 25 mars 2014, Vuckovic c/ Serbie, n° 17153/11, § 4). En effet, afin de conférer une résonnance concrète et effective à la Convention, la Cour s’efforce de ne pas priver les requérants des garanties auxquelles ils aspirent en raison d’une application excessivement rigoriste des normes procédurales jalonnant la vie contentieuse. Dans l’arrêt Zubac, la Cour affirme clairement qu’un « « formalisme excessif » peut nuire à la garantie d’un droit « concret et effectif » » (CEDH, (GC), 5 avril 2018, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, § 97). La souplesse dont fait preuve la Cour s’illustre non seulement au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours, mais également dans le cadre du droit à un tribunal.
la Cour s’efforce de ne pas priver les requérants des garanties auxquelles ils aspirent en raison d’une application excessivement rigoriste des normes procédurales jalonnant la vie contentieuse
En l’espèce, le requérant relevait qu’il n’avait pas eu la possibilité matérielle de saisir son recours devant la Cour d’appel de Douai via la plateforme e-barreau. Pourtant, nonobstant les circonstances matérielles particulières de l’espèce, la Cour de cassation avait jugé « que le recours en annulation formé par le requérant aurait dû être remis par voie électronique en application des articles 1495 et 930-1 du CPC » (§ 45). C’est précisément cette application mécanique et intransigeante de la norme qui emporte constat de violation de l’article 6. Il ne faudrait toutefois pas se méprendre sur la portée de cette condamnation. Ce n’est pas fondamentalement la dématérialisation de l’accès à la justice qui est en cause en l’espèce. En effet, la Cour affirme être « convaincue que les technologies numériques peuvent contribuer à une meilleure administration de la justice et être mises au service des droits garantis par l’article 6 § 1 » (§ 46). Ainsi, en imposant le dépôt d’une requête par voie électronique, l’ingérence de l’État dans le droit à l’accès au juge poursuit bel et bien un but légitime (§46). De même, la restriction dans l’exercice de ce droit a bien été considérée comme prévisible au regard des dispositions de l’article 930-1 du CPC qui impose explicitement une transmission des actes de procédure par voie électronique. Un doute pouvait néanmoins subsister quant à savoir si le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale relevait bien du champ d’application de ce texte. Sur ce point, la Cour retient que ni l’arrêté d’application de cet article du 30 mars 2011, ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013 ne pouvaient être interprétés comme instituant une exception à l’obligation de déposer un recours électronique à l’occasion d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale.
Le cœur de la condamnation ne repose donc pas sur l’existence ou l’inopportunité des dispositions normatives en droit interne, mais bien sur la manière dont elles ont été appliquées, concrètement, à la situation du requérant. En effet, fidèle à son approche in concreto, la Cour accorde une grande importance aux « circonstances de l’espèce » (§ 57). Rentrant alors dans le détail du fonctionnement du site e-barreau, la Cour relève que « la remise par voie électronique de son recours en annulation sur e-barreau supposait que l’avocat du requérant complète un formulaire en utilisant des notions juridiques impropres ». Pour introduire son recours en annulation devant la Cour d’appel via le site e-barreau, l’identification des parties se déclinait sous le vocable classique de « l’appelant » et de « l’intimé ». Or, le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’est pas un appel contre la sentence arbitrale. Par conséquent, l’utilisation du formulaire e-barreau « supposait que l’avocat du requérant complète un formulaire en utilisant des notions juridiques impropres » (§ 54). Ainsi, au regard de ces difficultés matérielles réelles et concrètes, la Cour européenne ne peut tenir le requérant responsable de l’erreur procédurale en cause. Elle en conclut qu’il serait « excessif de la mettre à sa charge » (§ 56). La Cour de cassation a été insensible à cet argumentaire, tiré des circonstances particulières de l’espèce. Se contentant d’appliquer la norme, sans l’ajuster à la situation tout à fait particulière de cette espèce, la Cour de cassation a bel et bien péché par excès de formalisme. Cette interprétation rigoriste de la norme est d’autant plus contestable qu’elle était susceptible de méconnaitre non seulement l’esprit, mais plus encore la lettre de l’article 930-1 du CPC. Ce dernier dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Toutefois l’alinéa 2 précise que « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». L’impossibilité de saisir le recours en annulation via le formulaire e-barreau sans utiliser des notions juridiques inexactes aurait pu inciter la Cour de cassation d’y voir une « cause étrangère » justifiant le recours à la voie papier. L’intransigeance de la Cour de cassation est donc synonyme de formalisme excessif portant atteinte à l’équité du procès. La Cour européenne n’hésite pas à relever, pour étayer la motivation de sa décision, que le conseiller de la mise en l’état avait lui-même retenu, par une ordonnance du 29 janvier 2015, que l’impossibilité d’identifier les parties sous la dénomination « demandeur » « défendeur » s’apparentait à une « cause étrangère » justifiant la recevabilité d’un recours sur support papier.
La critique principale adressée à la Cour de cassation est donc d’avoir adopté une lecture formelle de la règle de procédure sans prendre « en compte les obstacles pratiques auxquels s’était heurté le requérant ». En outre, les conséquences concrètes du raisonnement suivi par la Cour de cassation (conduisant in fine à valider la sentence arbitrale prononcée) sont « particulièrement rigoureuses » (§ 57) pour le requérant au regard des enjeux financiers sous-tendant le litige.
Ainsi, cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence visant à préserver un juste équilibre entre « le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et le droit d’accès au juge » (§ 58). La Cour note à cet égard que le droit d’exercer un recours en droit interne ne doit ni souffrir d’un « excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure » ni traduire « une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois » (§ 43 ; voir aussi CEDH, 12 janvier 2021, Albuquerque Fernandes c/ Portugal, n° 50160/13, § 70). Elle considère en effet que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dès lors que les règles procédurales ne sont plus au service de la « sécurité juridique et de la bonne administration de la justice » (CEDH, 18 mars 2021, Petrella c/ Italie, n° 24340/07, § 48), mais constituent « une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente » (CEDH, 1er juillet 2021, Association Burestop 55 c/ France, n° 56176/18, § 66). Il en va ainsi, comme en l’espèce, lorsque « l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire » prive l’intéressé de l’examen au fond de sa demande (CEDH, 19 novembre 2020, Efstratiou c/ Grèce, n° 53221/14 § 43).
Si la solution retenue par la juridiction strasbourgeoise apparait classique eu égard à sa jurisprudence antérieure bien établie, il n’en demeure pas moins que cette décision renouvelle encore une fois la délicate question d’un contrôle hiérarchique de fait qu’opère la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour de cassation. Nonobstant les subtilités et les précautions de langage pour éviter de s’ériger en quatrième degré de juridiction, cette décision confirme un peu plus encore que la Cour européenne est en passe de devenir la Cour des cours au sein du Conseil de l’Europe.
II. La finesse de la Cour européenne
Dans cette décision Xavier Lucas contre France, la Cour européenne fait preuve de tact et de finesse. En effet, tout en prenant soin de ne pas heurter (voire vexer) la Cour de cassation française par l’emploi d’une sémantique particulièrement offensante (A), la Cour européenne ne renonce pas, dans le fond, au contrôle qu’elle opère sur les plus hautes juridictions nationales et s’érige ainsi de fait en ultime voie de recours au sein de la grande Europe (B).
A. Les remontrances courtoises de la Cour européenne
L’analyse de la décision permet de mettre en évidence que la Cour européenne, alors même qu’elle condamne substantiellement l’interprétation retenue par la Cour de cassation, prend soin de ne pas heurter la sensibilité de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire interne français. La Cour européenne ne manque pas ainsi de relever qu’en ce qui concerne la prévisibilité de l’ingérence, la Cour de cassation « a motivé son raisonnement avec clarté » et « ne voit pas de raison sérieuse de s’écarter de la conclusion à laquelle » elle est parvenue (§ 50). Cette distribution de bons points juridiques participe d’une diplomatie juridictionnelle qui permet d’éviter les affronts verbaux peu propices à la sérénité du dialogue des juges. Il n’est pas non plus anodin de relever qu’au § 57 de cet arrêt, les juges de Strasbourg, alors même qu’ils s’apprêtent à retenir l’excès de formalisme patent du juge judiciaire, prennent le temps et le soin de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour européenne « de remettre en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cassation pour infirmer la solution retenue par la Cour d’appel de Douai ».
Cette précision n’était pas indispensable en l’espèce. La Cour européenne aurait très bien pu affirmer, sans autre précaution, que la Cour de cassation avait, au regard des circonstances de l’espèce, « fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif » (§ 57). Néanmoins, le rappel et le respect de ce qui se rattache, en partie, à l’autorité de la chose jugée par la Cour de cassation ont le mérite d’exister et permettent sans doute d’éviter toute vexation inutilement blessante pour le juge interne. La courtoisie langagière dont fait preuve la Cour européenne doit être soulignée, car il n’en a pas été toujours ainsi.
En effet, la Cour européenne a su par le passé se montrer beaucoup moins complaisante à l’égard de la Cour de cassation. Dans l’affaire Dulaurans c/ France, la virulence du langage de la Cour à l’égard de la Cour de cassation fût un douloureux souvenir pour le juge judiciaire. À la suite de la déclaration d’irrecevabilité par la Cour de cassation de l’unique moyen produit par la requérante au motif qu’il serait nouveau, la Cour européenne donne une véritable leçon de procédure en concluant, par une expression redoutable, qu’elle a commis une « erreur manifeste d’appréciation » (CEDH, 21 mars 2000, Dulaurans c/ France, n° 34553/97, § 38). La rudesse de cette condamnation, d’autant plus mal reçue par le juge judiciaire qu’elle reposait sur une expression tirée de la jurisprudence du Conseil d’État, avait provoqué un « conflit terrible avec la Cour de cassation »[1].
Ultérieurement, dans un arrêt Bauchan contre Ukraine de 2015, la Cour reviendra sur l’affaire Dulaurans en expliquant ce que recouvre l’erreur manifeste d’appréciation : il s’agit de l’erreur de fait ou de droit « évidente » commise par le juge national, « en ce sens que nul magistrat raisonnable n’aurait pu la commettre » (CEDH, 5 février 2015, Bochan c/ Ukraine, n° 22251/08, § 61). La charge est lourde et à peine voilée.
Dans la même veine, un rapport de la Commission en date du 12 octobre 1994 (Affaire Fouquet c/ France), relevait que la Cour de cassation avait « manifestement commis une erreur d’appréciation » en ne tirant pas toutes les conséquences du fait que les conclusions de la requérante comportaient, au-delà de la demande à titre subsidiaire, une demande à titre principal (CEDH, Commission (deuxième chambre), 12 octobre 1994, Fouquet c/ France, n° 20398/92, § 37)…
Ces quelques illustrations ne sont plus que de lointains souvenirs, car la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme fait désormais preuve d’une plus grande délicatesse. Cependant, la retenue et la diplomatie à laquelle s’astreint la Cour ne doit pas évincer le cœur du problème, à savoir l’intensité du contrôle opéré par la Cour lorsqu’est en cause une décision rendue par les juridictions suprêmes de l’ordre interne. En effet, même si, comme dans l’affaire commentée, la Cour entoure sa condamnation d’un langage moins frontal envers la Cour de cassation, celle-ci n’a nullement renoncé à exercer un contrôle rigoureux de la pratique des juridictions internes. Il faut pour s’en convaincre se rappeler que dans l’arrêt Winterstein, la Cour européenne précise que les autorités nationales (aux premières desquelles figure le juge !) jouissent certes d’une marge d’appréciation dans les domaines politiques sensibles « même si la Cour demeure habilitée à conclure qu’elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation » (CEDH, 17 octobre 2013, Winterstein c/ France, n° 27013/07, § 148). De même, dans l’affaire Tourisme D’affaires, la Cour conclut sa démonstration en affirmant que la Cour de cassation « n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation », sous-entendant par là même que telle aurait pu être le cas (CEDH, 16 février 2012, Tourisme d’affaires c/ France, n°17814/10, § 34).
Aussi, si le langage du juge indique désormais une forme de retenue, du moins à l’endroit de la Cour de cassation française, son contrôle se montre, au-delà des mots usités, toujours plus assidu.
B. L’instauration progressive d’une Cour des cours
La décision Xavier Lucas a le mérite de rappeler qu’en matière de droits fondamentaux, la Cour européenne a le « pouvoir du dernier mot »[2]. En effet, même si la Cour n’est pas de jure au sommet de la pyramide de l’ordre juridique, elle se situe de facto dans une position privilégiée dans le cadre de ce concert de pyramides en réseau (François Ost et Michel van de Kerchove, « De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 44, no. 1, 2000, pp. 1-82). Dans la décision soumise à commentaire, la Cour a bien rappelé qu’il ne lui appartenait pas de « remettre pas en cause le raisonnement juridique suivi par la Cour de cassation » (§ 57), néanmoins c’est bel bien in fine de cela dont il est question dès lors qu’elle opère un contrôle de conventionnalité déguisée de la décision de la Cour de cassation. Dans de nombreuses affaires, le Gouvernement de l’État mis en en cause s’emploie fréquemment à rappeler que la Cour européenne « n’est pas un quatrième degré de juridiction » (CEDH, 2 septembre 2021, Z.B. c/ France, n° 46883/15, § 41 ; CEDH, 17 janvier 2012, Zontul c/ Grèce, n° 12294/07, § 78).
Bien évidemment, en l’état du droit positif, la Cour ne peut être considérée comme un quatrième degré de juridiction. Elle a au demeurant récemment réaffirmé que « dans le cadre de son contrôle, elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance » (CEDH, 24 mars 2022, Benghezal c/ France, n° 48045/15, § 34). Néanmoins, derrière l’évidence de cette affirmation réside une réalité plus nuancée qu’il convient de ne pas négliger, et ce pour au moins deux raisons.
la Cour européenne devient inévitablement de facto un juge de quatrième degré de juridiction dès lors que les juridictions nationales ont commis une erreur manifeste, grossière, ou flagrante de droit ou de fait
D’une part, si l’on s’en tient à la lettre précise de la jurisprudence de la Cour, l’affirmation selon laquelle la Cour ne serait pas un quatrième degré de juridiction n’est pas absolue, mais bien assortie d’une exception. Concrètement, la Cour se refuse, au nom du principe de subsidiarité, de remettre en cause l’appréciation des tribunaux nationaux « sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ». C’est précisément ce raisonnement qui fonde et justifie la condamnation de la France dans l’affaire Xavier Lucas. Même si la Cour n’emploie pas cette formulation, il ne fait guère de doute que le formalisme excessif de la Cour de cassation a bien été considéré comme manifestement déraisonnable, et partant, a justifié de remettre en cause l’appréciation portée par la juridiction interne. Le message est donc limpide : la Cour européenne devient inévitablement de facto un juge de quatrième degré de juridiction dès lors que les juridictions nationales ont commis une erreur manifeste, grossière, ou flagrante de droit ou de fait. Ainsi, dans l’affaire Khamidov contre Russie (où de très nombreux éléments étayaient la destruction d’une propriété privée par les forces de l’ordre dont la responsabilité n’avait pas été retenue par les juridictions internes) , la Cour n’a pas hésité à relever que le « caractère déraisonnable de cette conclusion est si flagrant et manifeste que les décisions en question revêtent un caractère grossièrement arbitraire » entrainant une violation de l’article 6 (CEDH, 15 novembre 2007, Khamidov c/ Russie, n° 72118/01 § 174). De même, dans l’affaire Andelkovic où tous les éléments démontraient que le requérant avait bien droit au paiement de ses heures supplémentaires, la Cour remarque que le refus opposé par la juridiction nationale supérieure n’avait « aucune base légale » et s’analysait en un « déni de justice » (CEDH, 9 avril 2013, Andelkovic c/ Serbie, n° 1401/08, § 27). À l’instar de la décision du 9 juin 2022 et nonobstant la retenue dont fait preuve la Cour, il apparait clairement que les juges de Strasbourg n’hésitent pas à contrôler et censurer le raisonnement tenu par les juridictions suprêmes internes.
D’autre part, et au-delà de cette politique jurisprudentielle, c’est plus fondamentalement l’office du juge européen qui est inévitablement conduit à s’aventurer dans le contrôle de conventionnalité des décisions des juges nationaux. En effet, comme l’énonce en particulier l’arrêt Maumousseau, la responsabilité de la France « peut être engagée quelle que soit l’autorité nationale à qui est imputable le manquement allégué à la Convention dans le système interne » (CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c/ France, n° 39388/05, § 103). Or, les juridictions internes constituent bien évidemment une autorité nationale (de la plus haute importance au demeurant aux yeux de la Cour). Si bien que, sur le plan des principes, rien, si ce n’est le respect naturel envers l’autorité judiciaire, ne justifie de traiter différemment une violation de la Convention en fonction de son origine administrative, politique ou judiciaire. Dès lors que la responsabilité de l’État est engagée en raison du comportement de ses juridictions, il ne faut guère s’étonner que la condamnation de ce dernier s’analyse en réalité comme la condamnation de la jurisprudence des juridictions internes. Plus encore, eu égard au mouvement concomitant de conventionnalisation et de fondamentalisation, ces hypothèses de mises en cause directes de la jurisprudence nationale n’ont pas vocation à se tarir. Aussi, sans le dire expressément et sans l’assumer totalement, la Cour européenne est susceptible de devenir la Cour des cours de « l’ordre public européen ».
[1] J.-P. COSTA, « Le Conseil d’État a presque complètement intégré la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », AJDA, 2007, p. 60.
[2] F. LAZAUD, L’exécution par la France des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUAM, 2006, p. 254.